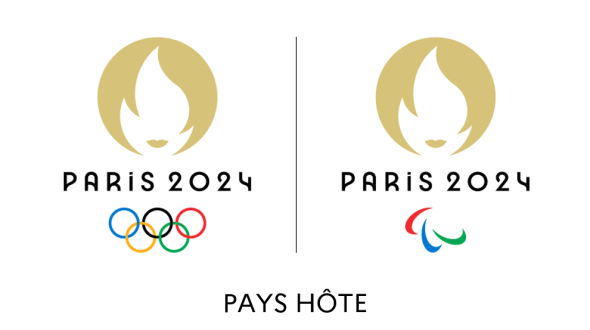Le contrôle interne au sein des forces de sécurité intérieure était au menu de la 7e table ronde du Beauvau de la sécurité, qui s’est tenue le 27 août.
Les débats portaient sur l’articulation autour du contrôle interne, du rôle essentiel des inspections générales de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, et du contrôle exercé au quotidien par l’ensemble de la chaîne hiérarchique.
Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a tout d’abord précisé que le contrôle de l’action des forces de sécurité ne relevait pas de la seule responsabilité de l’inspection générale de la Police nationale (IGPN) et de l’inspection générale de Gendarmerie nationale (IGGN). Il souhaitait que les débats de la journée puissent également porter sur la façon dont le contrôle s’exerçait de manière générale sur ceux qui détiennent le monopole de la violence légitime consentie par l’Etat. Le ministre a également tenu à rappeler que, sur les plus de cinq millions d’interventions de la Police et de la Gendarmerie, « 99% se passaient sans aucune réclamation, donc sans aucune saisine administrative ou de la justice ».
Gérald Darmanin a par ailleurs insisté sur le fait que transparence, confiance et contrôle étaient indissociables dans notre société démocratique. Qu’il appartenait à chacun « de mettre en place ce contrôle » qui ne doit pas seulement être envisagé comme une punition, mais aussi être vécu comme « une pédagogie, un accompagnement, une écoute ». Le ministre de l’Intérieur a émis le souhait d’une réflexion commune, ainsi que des propositions, sur la façon de faire évoluer le contrôle interne.
A la suite du ministre, Michael Lockwood, directeur général de l’Independent Office for Police Conduct (IOPC’s indépendence) est revenu sur l’expérience britannique et la création de cette instance indépendante qui supervise le système de gestion des plaintes déposées contre les forces policières de l’Angleterre et du Pays-de-Galles pour réinstaurer la confiance entre la population et sa police. Selon Michael Lockwood, l’indépendance constitue d’ailleurs la condition sine qua non d’un contrôle efficace. « Nous sommes indépendants du gouvernement et des forces de l’ordre mais indépendance ne veut pas dire isolement et distance. Je visite régulièrement les forces de l’ordre pour comprendre leurs contraintes et la charge qu’ils portent ». Michael Lockwood a également indiqué que l’IOPC, forte d’un millier d’agents répartis dans plusieurs antennes régionales, était chargée de conduire les enquêtes. Cependant, la décision d’engager une procédure disciplinaire revenait à la hiérarchie policière et que le procureur était le seul décisionnaire en matière de poursuites pénales.
Invitée à prendre la parole lors de cette table ronde, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a tenu à rappeler les propos du Premier ministre lors de la séance inaugurale du Beauvau de la sécurité, à savoir que « les forces de l’ordre exercent un métier qui n’est en rien un métier comme les autres ». Leur charge est immense comme l’indique le code de la sécurité intérieure ; il leur revient d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l‘ordre public ainsi que la protection des personnes et des biens. « Ces missions sont exigeantes. Elles peuvent être épuisantes, j’en suis consciente, d’autant plus dans un contexte de crise et de tension ».
Claire Hédon a ensuite rappelé qu’elle était en charge du contrôle externe, tout comme l’autorité judiciaire et d’autres autorités administratives indépendantes. A ce titre, elle était chargée du contrôle du respect de la déontologie par les forces de sécurité. Et en matière de contrôle interne et de respect de la déontologie, la défenseure des droits a insisté sur l’importance du contrôle par les pairs.
Concernant les deux inspections (IGPN et IGGN), la défenseure des droits a souligné qu’elle n’a jamais été saisie de griefs mettant en cause la qualité ou l’impartialité de leurs enquêtes. Dans l’exercice du contrôle externe, elle se sert des enquêtes menées par les deux inspections. « Lorsque nos conclusions rejoignent celles des inspections et que des sanctions ont été prononcées, nous en prenons acte. En revanche, lorsque nous considérons que les enquêtes ne répondent pas aux griefs du réclamant ou laissent subsister des zones d’ombre, nous diligentons alors des actes d’investigation supplémentaires ».
La défenseure des droits a ensuite longuement insisté sur la notion de transparence: « c’est une exigence à laquelle un corps de contrôle, comme l’IGPN et l’IGGN, ne saurait déroger. Elle est indispensable à ce qui fonde la légitimité d’un corps, sa capacité à être impartial et à être perçu comme tel. Elle contribue à l’exemplarité et à l’image d’exemplarité, et permet de lever les soupçons ». Selon elle, cette transparence « doit être assortie d’autres garanties qui tiennent à sa composition, au cadre de ses interventions et à son fonctionnement ». En conclusion, Claire Hédon s’est dit convaincue que la principale qualité d’un corps de contrôle est l’impartialité, car « c’est d’elle que dépend la confiance que la population lui accorde ».
Brigitte Julien, directrice de l’IGPN a rappelé que le premier contrôle des policiers était exercé par la hiérarchie, puis les directions de police et l’IGPN exerçaient un contrôle de second niveau, pour les affaires les plus sensibles. Elle est ensuite revenue sur la profonde réforme de l’IGPN engagée depuis 2012, « au nom de la transparence et de l’obligation de rendre compte », matérialisée par :
- la publication et la présentation à la presse de son rapport annuel,
- la mise en place d’outils de mesure comme le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA) et le recensement des particuliers blessés ou tués à l’occasion des missions de police (RBD)
- L’ouverture du service à des magistrats, universitaires et contractuels.
Brigitte Julien a également évoqué « l’une des pièces maîtresses de la réforme à savoir la création de la plateforme de signalements ouverte au public ».
La cheffe de l’inspection générale de la Police nationale a également rappelé qu’elle réunirait prochainement le comité d’évaluation de la déontologie de la Police nationale (CEDPN) composé de magistrats, d’experts, de policiers et de journalistes et qui deviendra à terme « un véritable espace de réflexion sur les pratiques policières et sur l’évolution des doctrines d’emploi. Nous avons conscience que l’attente de transparence est forte et légitime. Nous devons le faire plus et mieux, notamment en terme de communication, de compte-rendu et d’ouverture ».
Le général Alain Pidoux, chef de l’IGGN, a indiqué de son côté, qu’agir pour plus de transparence et d’efficience passait, selon lui, par quatre actions : rendre compte à la société de son action ; communiquer en interne et en externe ; s’ouvrir, en intégrant des personnels civils et des magistrats ; et se transformer en modernisant son organisation et en favorisant l’accessibilité de ses services.
Gérald Darmanin a souhaité que les corps d’inspection rendent leurs rapports d’enquête plus rapidement, à la fois pour les personnels concernés mais également pour le public, afin de limiter toute suspicion de connivence.
Les deux inspections générales, comme les représentants des gendarmes et des policiers, ont rappelé que la mission des inspections générales ne se résumait pas aux enquêtes pour faute ou manquement, mais qu’une grande part de leur activité consistait également à effectuer des audits, des études, des analyses juridiques, et à formuler des préconisations et des recommandations afin d’améliorer le fonctionnement des services. Pour la grande majorité des policiers et des gendarmes, ces inspections doivent rester des outils à la main des directeurs généraux, et leurs personnels ne peuvent être que des personnes qualifiées connaissant les métiers et les techniques d’intervention.
Comme lors de chaque table ronde du Beauvau de la sécurité, les représentants syndicaux des policiers et les gendarmes du conseil de fonction militaire de la Gendarmerie ont été invités à s’exprimer. Beaucoup ont regretté les critiques de certains médias à l’encontre des inspections générales. Mais, comme le rappelait un participant, « les inspections générales sont craintes par l’ensemble des policiers et gendarmes. Une convocation est toujours source de stress et d’inquiétude. En serait-il ainsi s’il s’agissait de services de complaisance ? »
Les policiers et gendarmes ont rappelé que « les enquêtes judiciaires se faisaient sous la responsabilité et la direction des magistrats. C’est donc bien de facto à un contrôle externe que sont soumis nos collègues. ». « Et n’oublions pas que les policiers et les gendarmes savent que leurs actions sont soumises au contrôle de leur hiérarchie, des inspections générales, à l’examen critique du défenseur des droits, du contrôle du procureur et de la sanction des juges, a souligné un syndicaliste policier, aucune profession en France ne fait l’objet d’un contrôle aussi minutieux et vigilant ».
Il reste que la majorité des représentants des policiers et des gendarmes se sont accordés sur la nécessité d’améliorer certains aspects du contrôle interne, notamment en matière de rapidité des enquêtes ou de défense des policiers et gendarmes faisant l’objet de ces enquêtes.
Concluant la séance, le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’évoquer le contrôle interne dans une table ronde, c’était déjà montrer un « bel esprit de transparence » de la part de la police et de la gendarmerie, mais qu’il était néanmoins convaincu que des améliorations, notamment dans les process, étaient nécessaires. Il a de nouveau insisté sur le nécessaire du renforcement du contrôle hiérarchique, et particulièrement celui de la hiérarchie intermédiaire, et à la tenue plus rapide des conseils de discipline. Il a également confirmé le rattachement de l’IGPN et de l’IGGN aux deux directeurs généraux.
Pour terminer, Gérald Darmanin s’est dit favorable à la mise en place d’un contrôle parlementaire, sur le modèle de ce qui se fait pour les services de renseignement (délégation parlementaire au renseignement). Les présidents de Chambre seront ainsi prochainement saisis de cette opportunité.